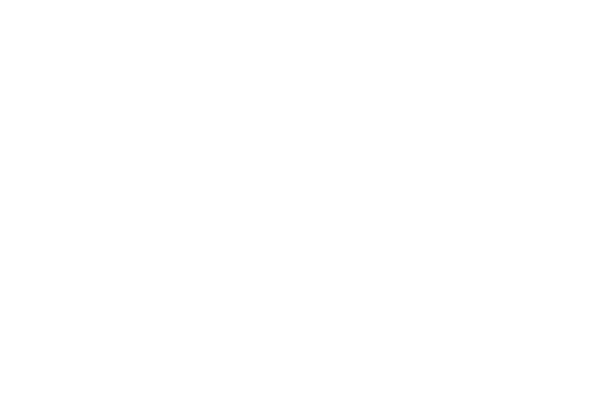Rétention des sauvegardes : comprendre, maîtriser et optimiser la durée de conservation de vos données
- novembre 10, 2025
- 6 minutes

La rétention des sauvegardes est un élément essentiel, souvent sous-estimé, de toute stratégie de protection des données. Elle détermine combien de temps vos données sauvegardées sont conservées, combien de versions sont disponibles et, par conséquent, vos capacités de restauration en cas d’incident.
Dans cet article, nous allons explorer en profondeur ce qu’est la durée de rétention, comment elle fonctionne, ses impacts techniques et comment la configurer efficacement pour allier sécurité, conformité et maîtrise du stockage.
Qu’est-ce que la durée de rétention des sauvegardes ?
La durée de rétention correspond à la période pendant laquelle un système de sauvegarde conserve l’historique des données qu’il protège. À chaque opération de sauvegarde, qu’il s’agisse d’une création, d’une modification ou d’une suppression de fichier, une nouvelle version est générée. Toutes ces versions sont historisées et conservées jusqu’à la fin de la période de rétention définie.
Cette logique permet à l’utilisateur de restaurer ses données à un état antérieur cohérent, en fonction des besoins : retour à une version spécifique d’un fichier, restauration d’une base de données à un instant T, etc.
Exemple : une règle de rétention fixée à 90 jours signifie que les données supprimées ou modifiées restent restaurables pendant trois mois avant leur suppression définitive.
Une durée de rétention mal paramétrée peut entraîner des coûts de stockage très importants, des performances dégradées ou, pire, une perte de données critiques.
Différents modes de fonctionnement
Une fois que l’on a compris le principe fondamental de la rétention il faut également considérer les différentes sources de données et le déclenchement de la sauvegarde, qui vont complexifier le modèle.
Par exemple, entre de la sauvegarde de machines virtuelles sur un hyperviseur et la sauvegarde de fichiers sur un postes nomades, la fréquence et le mode de fonctionnement des sauvegardes n’est pas le même, ce qui a un impact sur la rétention.
Dans le cas d’un hyperviseur, la fréquence des sauvegardes sera parfaitement maitrisée : la machine est toujours disponible et la sauvegarde sera réalisée à partir d’un cliché instantané, planifié.
Dans le cas d’une sauvegarde de fichiers sur un NAS, par exemple, la machine est toujours disponible. Mais si la sauvegarde est réalisée en sauvegarde continue, des versions de fichiers vont être générées au fil de l’eau sans maitrise d’une planification. Si la machine source n’est plus un NAS mais un poste nomade avec une disponibilité très incertaine (système et connexion réseau) la maitrise de la sauvegarde, et des versions générées, est encore plus complexe.
Différents modes de fonctionnement et leur impact sur la rétention sauvegarde
La politique de rétention ne s’applique pas de la même manière à toutes les sources de sauvegarde. En effet, le type de données et le mode de fonctionnement des machines influencent directement la fréquence des sauvegardes, le nombre de versions créées et donc la stratégie de rétention à adopter.
Machines virtuelles (hyperviseurs)
Les sauvegardes sont généralement planifiées de façon régulière et prévisible. Ce contexte stable permet de définir des durées de rétention relativement simples à maîtriser.
Serveurs de fichiers ou NAS
la sauvegarde peut s’appuyer sur des snapshots ou une logique de sauvegarde continue. Ces environnements génèrent potentiellement un grand nombre de versions, mais sur des petits fichiers facilement optimisés (compression et déduplication).
Postes nomades
La fréquence et la réussite des sauvegardes dépendent de la disponibilité du système et de la connexion réseau. La politique de rétention doit donc être plus souple, capable de gérer des sauvegardes irrégulières ou partielles.
Chaque environnement possède ses spécificités techniques. Comprendre ces différences est essentiel pour définir une stratégie de rétention adaptée, garantissant à la fois la cohérence des restaurations, l’efficacité du stockage et la conformité réglementaire.
Dans de nombreuses stratégies de sauvegarde, il n’est pas nécessaire de conserver le même niveau de détail sur toute la période de rétention.
La rétention dégressive (ou hiérarchisée) répond à ce besoin en réduisant la fréquence des versions conservées au fil du temps.
Le principe : les sauvegardes récentes sont conservées de manière fine, tandis que les plus anciennes sont espacées.
Par exemple, une organisation peut choisir de :
- Garder toutes les versions quotidiennes pendant quelques jours ou semaines ;
- Ne conserver qu’une version hebdomadaire au-delà d’un certain délai ;
- Ne sauvegarder qu’une version mensuelle ou trimestrielle sur le long terme.
Ce fonctionnement permet de maîtriser le volume de stockage, tout en maintenant des points de restauration représentatifs des périodes clés.
Chaque système ou éditeur peut proposer des méthodes et des filtres différents pour implémenter cette logique.
L’important est de comprendre que le paramétrage doit refléter les besoins métiers : fréquence de modification, criticité des données, contraintes réglementaires, etc.
Comment optimiser la rétention pour une stratégie de sauvegarde performante ?
La plupart des solutions de sauvegarde professionnelles appliquent une rétention par défaut.
Ce paramétrage par défaut correspond à ce que l’éditeur a évalué comme un bon compromis.
En réalité, ces modèles devraient toujours rester modifiable et personnalisable selon vos besoins métiers, réglementaires ou techniques. Il est donc crucial de le prendre en compte lors du choix de votre prestataire de sauvegarde.
Dans certains secteurs (santé, finance, administration publique, etc.), la durée de conservation des données est régie par des obligations légales.
Une politique de rétention bien paramétrée permet de respecter les exigences RGPD ou ISO 27001. C’est aussi une manière d’éviter la conservation excessive de données sensibles et de garantir la traçabilité et l’intégrité des sauvegardes.
Conclusion : faites de la rétention un levier d’efficacité, pas une contrainte
La rétention de sauvegarde dépasse largement la simple notion de durée de conservation. C’est un paramètre stratégique qui conditionne la performance, la maîtrise des coûts et la conformité de votre infrastructure IT.
Une politique de rétention bien pensée permet :
- D’optimiser les performances en limitant la charge et la taille des historiques
- De réduire les coûts en ajustant la consommation de stockage aux besoins réels
- D’assurer la fiabilité et la conformité en garantissant des restaurations rapides et cohérentes.
En adaptant votre politique de rétention à la fréquence des sauvegardes, à la nature des données et aux exigences réglementaires de votre secteur, vous transformez une contrainte technique en véritable levier de sécurité, d’efficacité et de résilience opérationnelle.
Pour des exemples plus précis liés à notre service de sauvegarde Arx One Backup, vous pouvez retrouver notre article dédié sur notre site d’aide.
Parcourez toutes nos dernières actualités
Pour tout savoir sur nos nouveautés, nos événements et l’actualité backup
Pour partager nos articles sur vos réseaux sociaux